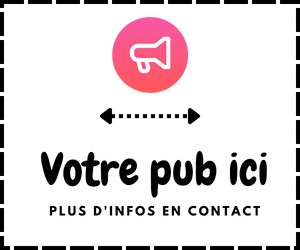Auteur d’une biographie reconnue sur le compositeur (parue chez Fayard en 1999), Brigitte François-Sappey apporte quelques éclaircissements sur la vie de Robert Schumann. Le musicien méritait ce complément de connaissances, d’autant plus opportunes en 2006, qui marque les 150 ans de la mort. Dernières découvertes sur l’internement du compositeur ; estimation de son unique opéra, « Genoveva » ; dates-clé pour comprendre l’évolution du style. Entretien.
Quelles ont été les plus grandes découvertes ou avancées de la recherche concernant Schumann depuis ces quelques dernières années ?
La plus décisive est sans doute le dépôt à l’Akademie der Künste de Berlin, après la chute du mur, des carnets du Dr Richarz par son petit-neveu Aribert Reimann, le célèbre compositeur et pianiste allemand. On croyait perdus ces carnets du thérapeute de Schumann à l’asile d’Endenich (Bonn). C’était donc inexact. Mais il manque quasiment tout ce qui concerne les mois décisifs allant de son arrivée, le 4 mars 1854, au 6 septembre 1854 (pages détruites, dit-on, durant la Seconde Guerre mondiale). Déposés en 1991, les carnets sont d’abord demeurés inaccessibles à la consultation pour des raisons « éthiques ». Huit pages de synthèse ont été publiées par Franz Hermann Franken en 1994. Depuis, le romancier Peter Härtling et le musicologue Eric Frederick Jensen ont obtenu l’autorisation de compulser les précieux témoignages, et Ernst Burger a pu en publier quelques extraits. Évitant la querelle des diagnostics, les auteurs écartent néanmoins celui de psychose maniaco-dépressive au profit d’une syphilis mal définie. Le 12 septembre 1855 (jour anniversaire du mariage du musicien), Richarz note : « Il écrit à nouveau ces derniers temps des réflexions acerbes au contenu mélancolique, et note par exemple : « en 1831, j’étais syphilitique et j’ai été traité avec de l’arsenic. »
Parmi les nouveautés décisives, il faut également compter avec le Catalogue thématique, colossal et magistral, la Bible schumannienne, de
Margirt L. McCorkle, Robert Schumann, Thematisch-Bibliographisches Werkverzeichnis (Munich, Henle, 2003).
Si vous deviez compléter votre biographie sur le compositeur, référence reconnue et légitimement célébrée, quel(le) partie ou aspect de l’œuvre, souhaiteriez-vous approfondir et pourquoi?
Je crois avoir envisagé avec attention et équité toutes les œuvres, même si chacune pourrait justifier un livre entier. J’espère surtout la reconnaissance générale des partitions des dernières années de Schumann, que Liszt portait déjà au pinacle. On ne saurait insister assez, par exemple, sur la beauté, l’émotion et la nouveauté des œuvres de chambre en forme de fantaisie et de conte (Märchen). Comme Brahms, qui les a éditées en 1893, je souhaiterais entendre partout l’Andante et Variations opus 46 (1843) dans sa version originale d’Andante und Variationen für 2 Pianoforte (sic), 2 Violoncelle und Horn.
Schumann, individu fragile et malade, mélancolique voire suicidaire… êtes-vous d’accord avec cette image qu’on ne cesse de développer ici et là? Doit-on vraiment comprendre sa musique sous le seul spectre de sa névrose? Ne peut-on pas comprendre aussi sa musique comme l’expression d’un combat tourné vers la lumière?
Schumann était indéniablement fragile, névrosé, phobique, hanté par le spectre de la folie et suicidaire. Mais, fondamentalement « sain » et près du terroir, ce grand intellectuel et artiste a joué avec un art consommé de ses pulsions et en a fait les éléments créatifs de son incomparable dialectique musicale. L’art, c’est la maîtrise. Seul celui qui maîtrise ses forces et voix intérieures peut composer avec l’idée d’un carnaval généralisé des êtres (Carnaval) et des humeurs (Davidsbündlertänze, Humoreske) ou de la folie (Kreisleriana).
La preuve de la puissance de Schumann ? Le millier de numéros de sa Neue Zeitschrift für Musik, revue musicale de très haut niveau, qui parut dix années sous sa direction au rythme, sans faille, de deux numéros par semaine. Qui dit mieux ?
Il est indéniable cependant que Schumann connut les terribles attaques du stade tertiaire de la syphilis vers 1844-1846, et qu’après une magnifique et prolifique rémission il a sombré de nouveau en 1854.
Oui, Schumann lutte. Il n’est pas pour rien le roi David qui combat les Philistins, ou Florestan (issu de l’opéra Fidelio de Beethoven), héros enfermé dans son corps mais libre dans son âme et toujours espérant. Schumann applique à sa vie et à son art le précepte goethéen : « s’efforcer des ténèbres vers la lumière. » Il n’a pas manqué, dans ses splendides Scènes de Faust, taillées à même les vers de Goethe, de retenir cette sentence des instances divines dans le Second Faust : « Wer immer strebend sich bemüht,/ Den können wir erlösen (Qui a toujours fourni de rudes efforts,/ Celui-là, nous pouvons le racheter). »
L’un des aspects les plus méconnus du parcours de Schumann est son chemin mystique.
Quelles seraient les trois principales oeuvres/ compositions de Schumann dont vous ne pourriez-vous défaire ?
Toutes ! Cette totalité m’est nécessaire en ce qu’elle est l’essence même, être et œuvre, de Schumann, toujours déchiré entre le Fragment et le Tout, le Multiple et l’Un. A défaut de cette indispensable totalité, et pour me reconstituer une « totalité jivaro », je retiendrais peut-être la Fantaisie opus 17 pour piano, Dichterliebe opus 48, cycle de lieder, les Scènes de Faust qui allient soli, chœur et orchestre, profane et sacré.
Que penser de son unique ouvrage lyrique, Genoveva? Essai manqué ou chef-d’oeuvre unique?
Les deux ! Chef-d’œuvre de psychologie et de subtilité musicale, mais anti-opéra, voulu tel par le compositeur, en des temps où le public ne pouvait comprendre cette démarche. Même aujourd’hui, il semble que Genoveva ne puisse rivaliser jamais avec l’autre anti-opéra qu’est Pelléas et Mélisande et que seul le disque puisse lui donner sa chance. Encore que… tout soit possible avec un chef et des interprètes convaincus et subtils.
Les 5 dates clés dans la carrière de Schumann.
1828
Arrivée du Saxon de presque dix-huit ans à Leipzig ; découverte de la pianiste et compositrice prodige Clara Wieck, de huit ans et demi, dont la présence, secrète ou avouée, innervera toute son œuvre, son journal intime et sa vie.
1830
décision de rejeter la jurisprudence au profit de la musique ; retour à Leipzig après les mois à Heidelberg et la vision prémonitoire du Rhin.
1836
Perte de sa mère, dix ans après celle du père ; farouche opposition de Wieck à des fiançailles avec Clara et rupture ; publication de la Sonate en fa dièse « dédiée à Clara par Florestan et Eusebius » et composition de Ruines, Fantaisie pour le Pianoforte (futur 1er mt de la Fantaisie op. 17).
1840
Année du lied, au plus atroce de son procès contre Wieck et de sa douleur (Leid). Et, finalement, mariage le 12 septembre avec Clara.
1854
Immersion dans le Rhin et la démence (non absolue) syphilitique, prélude à vingt-neuf mois de délabrement et d’agonie.
Propos recueillis par Alexandre Pham
Lire aussi notre chronique de la biographie de Robert Schumann par Brigitte François-Sappey (Fayard, 1999).
approfondir
Lire notre dossier consacré à Genoveva, l’unique opéra de Robert Schumann.