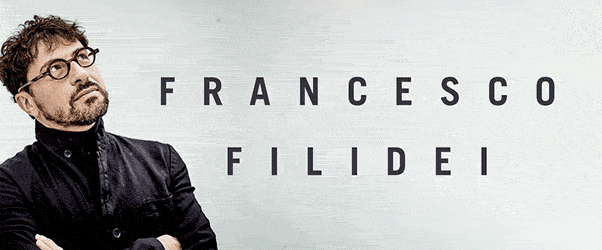Schumann historique
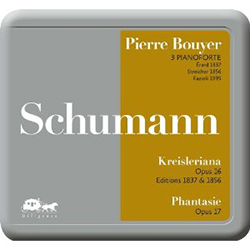 Schumann : Kreisleriana opus 16, Phantasie opus 17 (Pierre Bouyer, Erard, Streicher, Fazzioli. 2012). Sur 3 claviers différents et minutieusement choisis (en outre chacun parfaitement présenté et documenté dans l’abondante notice du coffret), passant de l’un à l’autre avec une honnêteté historique idéalement argumentée, le pianofortiste Pierre Bouyer travaille à révéler ce qui fonde ce romantisme filigrané d’un Schumann profondément schizophrénique: Eusebius et Florestan à la fois, d’une versatilité qui finit par dissoudre l’unité de l’esprit (mais pas la profondeur ni l’hypersensibilité de l’âme, bien au contraire…). Diffraction du matériau musical (entraînant la pensée même du musicien… ou richesse insondable d’un génie polymorphe ? Voilà une question passionnante que le geste en 3 claviers successifs pose d’emblée, outre la recherche tout aussi critique sur le style, la facture et la recréation interprétative abordés dans ce coffret passionnant à maints égards.
Schumann : Kreisleriana opus 16, Phantasie opus 17 (Pierre Bouyer, Erard, Streicher, Fazzioli. 2012). Sur 3 claviers différents et minutieusement choisis (en outre chacun parfaitement présenté et documenté dans l’abondante notice du coffret), passant de l’un à l’autre avec une honnêteté historique idéalement argumentée, le pianofortiste Pierre Bouyer travaille à révéler ce qui fonde ce romantisme filigrané d’un Schumann profondément schizophrénique: Eusebius et Florestan à la fois, d’une versatilité qui finit par dissoudre l’unité de l’esprit (mais pas la profondeur ni l’hypersensibilité de l’âme, bien au contraire…). Diffraction du matériau musical (entraînant la pensée même du musicien… ou richesse insondable d’un génie polymorphe ? Voilà une question passionnante que le geste en 3 claviers successifs pose d’emblée, outre la recherche tout aussi critique sur le style, la facture et la recréation interprétative abordés dans ce coffret passionnant à maints égards.
approche comparative
La démarche est d’autant plus troublante en définitive que l’instrument le plus récent (grand piano de concert Fazioli et sa mécanique imposante) dont nous sommes les plus familiers, est a contrario le moins légitime : Schumann ayant certainement davantage connu et éprouvé la palette sonore et les possibilités expressives comme techniques des deux claviers historiques plus anciens : deux pianoforte, Erard 1837 (collection du musicien) et Steicher 1856: occasion de comparer aussi à travers la digilité de l’interprète, les performances spécifiques entre les mécaniques française (moderniste et visionaire) et viennoise (raffinée mais passéiste).
On sait l’exultation que ressentait Schumann vis à vis de son propre corps, trop étroit dont il souhaitait changer ainsi qu’il l’a écrit ; le parallèle avec la versatilité du musicien dans le choix alternatif des instruments souligne évidemment la faculté du compositeur romantique à varier les formes, passer d’un état à l’autre, tendresse, ivresse, oubli et nostalgie certes mais aussi d’une mesure à l’autre, violence, rudesse, âpreté : autant de vertigineux contrastes que les instruments d’époque cisèlent avec un naturel captivant. Selon un phénomène mieux connu à présent grâce à l’approche de plus en plus fréquente, de mieux en mieux argumenté, sur instruments historiques, ce que l’interprète perd en définition, caractère, finesse, intensité, mordant, il le gagne en puissance, rondeur, éloquence chatoyante (Fazioli). L’apport est immédiatement plus séduisant mais le geste perd certainement en acuité expressive, précision dynamique, intimité ou pudeur flexible. Une rondeur séduisante assez uniforme ne finit-elle pas ici par lasser ?
Le plus honnêtement possible, Pierre Bouyer à travers les histoires différentes des trois claviers retrouve et fait émerger la puissance formidable des Kreisleriana, leur versatilité permanente, leur flux sanguin, cet écoulement instable et souvent imprévisible, en cela très bien servi par l’appareillage sensible et si présent des claviers historiques dont l’esthétique va à l’encontre de la neutralité des pianos modernes. Ce qui frappe immédiatement dans cette lecture historique et d’époque, c’est la présence matérielle des équilibres sonores dont la fluidité approchée par le pianiste sait faire murmurer le chant intérieur schumannien dans les plages les plus introspectives et rêveuses du compositeur Eusebius (Kreisleriana 3 et 4). Ici jouer les Kreisleriana dans leur version originelle de 1838 sur le Streicher viennois de 1856 éclaire le flux facétieux plus que dramatique, la couleur de la mobilité souveraine grâce au toucher subtile et sa réponse immédiate. L’écriture gagne en volubilité enfantine (Kresileriana 8).
D’une ampleur orchestrale, la sonorité de l’Erard s’accommode parfaitement de la version révisée des Kreisleriana de 1850: le Streicher pointait le relief et l’âpreté de chaque touche, l’Erard atteint une sonorité naturellement plus puissante liée à sa mécanique moins agile et légère ; d’emblée, c’est le corps de la mécanique qui se dévoile (son » grandiose ferraillement » comme l’explique très bien le claviériste dans son livret, porteur de nouvelles possibilités) avec une éloquence et un souffle généreux très impressionnant qui ferait passer Kreisleriana 1 tel un vaste portique, une déclaration de conquête plutôt qu’un doux chant de confession. Mais les graves sont magnifiques et les mediums très élargis, sombres et profonds (est-ce dû au ravalement par Pleyel? il il aurait été intéressant de préciser l’apport acoustique et musical de la restauration…). On comprend que les pianistes romantiques parmi les plus grands : Liszt, Clara et donc Robert Schumann (avant de s’y casser les doigts) l’ait immédiatement adopté. Que même Liszt en est conçu sa propre esthétique mystique ascensionnelle, du lugubre vers les cimes lumineuses. Du coup les sections plus intimes (plus chopiniennes que lisztéennes ?) manquent de subtilité flexible justement. Le caractère physique de la machine Erard s’accordant mieux à l’abattage rythmique des épisodes portés par l’emportement du compositeur Florestan. Mais ce supplément de brume et de pâte sonore font aussi les délices de Kreisleriana 2 dont les étagements produits par l’interprète conduisent au rêve tout autant.
La fluidité et l’égalité des registres proposée par le Fazioli fait immédiatement entendre les modulations harmoniques, la succession des constructions polyphoniques en un flux d’une prenante acuité. On y recherche en vain tout ce caractère et cette présence mécanique des claviers anciens : irrégularités, frottements, sécheresse aiguë di timbre, succession tuyautée, bruit des touches… Tout ce en quoi la mécanique » parle « … Ce Fazioli est une véritable Rolls : profondeur des graves, cœur palpitant des medium et aigus ronds et perlés… L’amateur des instruments historiques certes impressionné par cette mécanique rutilante au grand luxe sonore, recherche plutôt néanmoins les aspérités et tout ce fourmillement d’accents et nuances inattendus du Streicher et de l’Erard. L’écoute successive des trois pianos s’avère passionnante : elle souligne sans l’épuiser la thématique centrale chez Schumann de la disparité aérienne (ou liquide c’est selon la sensibilité de chacun) et de la liberté poétique (magistralement évoquée ici dans le choix pertinent du triptyque de la Phantasie opus 17 dédiée à Franz Liszt (1836-1838). Tel un artisan pianofortiste, Pierre Bouyer aborde le répertoire schumannien avec un grande exemplarité, en dévoilant l’esthétique de trois mécaniques aux champs esthétiques si opposés : l’honnêteté de la démarche sert évidemment le compositeur romantique car à chaque mécanique répond sous les doigts de l’interprète, une nouvelle cohérence musicale (avec toutes les questions esthétiques et interprétatives qui en découle par comparaison).
Pour les praticiens et les passionnés de jeux pianistiques, l’interprète ajoute dans le coffret de 3 cd une notice abondante, moins sur l’écriture schumanienne et l’esthétique des oeuvres choisies que sur la culture du mélomane discophile, offrant un panorama de l’histoire de l’interprétation au XXè : l’autorité de Horowitz, le lyrisme d’Arrau, la puissance émotionnelle de Kissin, la liquidité recréative d’Argerich, la culture d’Andras Schiff, l’actualisation de Mikhail Pletnev… à chacun de jalonner l’histoire de son propre goût grâce aux perspectives à la fois critiques et esthétiques que propose Pierre Bouyer. Artistiquement accomplie et d’une vertu pédagogique rafraîchissante, la démarche du pianosfortiste saura séduire perfectionnistes comme curieux en phase de découverte ou d’approfondissement.
Schumann: Kreisleriana opus 16 (éditions 1837 et 1856), Phantasie opus 17. Pierre Bouyer (Erard 1837, Streicher 1856, Fazioli 1995). 3 cd Diligence DIL 091011