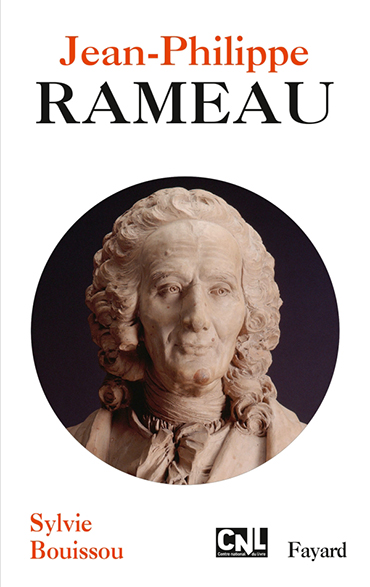 Entretien… Le Rameau nouveau de Sylvie Bouissou. Pour l’année Rameau 2014 (250 ans de la disparition du compositeur, décédé en 1764), Fayard publie une nouvelle biographie consacrée à Jean-Philippe Rameau (1683-1764). C’est à ce jour le texte le plus exhaustif qui devient de fait l’ouvrage de référence s’agissant du Dijonais. Son auteure, Sylvie Bouissou ne fait pas qu’y réunir tous les éléments développés depuis des années sur le plus grand génie musical français du XVIIIè, en un rare esprit de synthèse et dans une langue vivante et argumentée, c’est un homme attachant, hors normes voire libertaire et anticonformiste qui se précise enfin, au diapason de son œuvre : inclassable, protéiforme, d’une inventivité et d’une exigence jamais vue jusque là… Entretien avec Sylvie Bouissou, directrice de recherche au CNRS (IReMus).
Entretien… Le Rameau nouveau de Sylvie Bouissou. Pour l’année Rameau 2014 (250 ans de la disparition du compositeur, décédé en 1764), Fayard publie une nouvelle biographie consacrée à Jean-Philippe Rameau (1683-1764). C’est à ce jour le texte le plus exhaustif qui devient de fait l’ouvrage de référence s’agissant du Dijonais. Son auteure, Sylvie Bouissou ne fait pas qu’y réunir tous les éléments développés depuis des années sur le plus grand génie musical français du XVIIIè, en un rare esprit de synthèse et dans une langue vivante et argumentée, c’est un homme attachant, hors normes voire libertaire et anticonformiste qui se précise enfin, au diapason de son œuvre : inclassable, protéiforme, d’une inventivité et d’une exigence jamais vue jusque là… Entretien avec Sylvie Bouissou, directrice de recherche au CNRS (IReMus).
Selon vous, quels sont les éléments nouveaux les plus récents qui ont modifié notre connaissance de Rameau et que vous développez particulièrement dans votre texte ?
Le rôle des interprètes, des directeurs de théâtre et des maisons de disques est fondamental dans notre connaissance de Rameau. Déjà, certains titres ont connu plusieurs mises en scène, Platée, Hippolyte et Aricie, Les Indes galantes, Dardanus, Les Boréades, dont les lectures plurielles permettent de graver ces chefs-d’œuvre dans notre mémoire. Plus on jouera la musique de Rameau, plus le public captera son immense génie et aura envie de découvrir son œuvre, sa vie, ses combats, ses extravagances…
Ensuite, il y a les articles et les livres. En ce qui concerne le mien, je ne développe rien en particulier ; j’ai embrassé tout l’homme ! Je n’ai donc pas éliminé la carrière d’organiste de Rameau au prétexte qu’il n’avait pas laissé de répertoire pour cet instrument, mais au contraire, j’ai tenté de comprendre pourquoi il ne tenait pas en place et n’honorait aucun de ces contrats. De même, j’ai développé son attachement à l’esthétique de la foire qui favorise rien moins la création de Platée et des Paladins à travers ses collaborations avec Piron. C’était un bon vivant, assidu de la Société du Caveau, où se chantaient des airs à boire et des canons entre amis. Le fait d’avoir découvert que Rameau était l’auteur de « Frère Jacques » m’a procuré un choc incroyable ! Finalement, tout le monde a chanté du Rameau un jour. J’ai voulu comprendre les raisons des polémiques dans lesquelles il s’engage, tant sur le plan musical que théorique. Si la période 1733-1739 est mieux connue du public – avec les créations d’Hippolyte et Aricie, des Indes galantes, de Castor et Pollux, des Fêtes d’Hébé et de Dardanus –, celle de sa période de maître de clavecin parisien (dix ans tout de même de 1723 à 1733) ou celle correspondant à son statut de compositeur de la musique du roi (1745-176) le sont beaucoup moins, voire pas du tout. Je voulais éclairer ces pans si productifs et au cours desquels il opère des révolutions stylistiques, notamment avec le librettiste Cahusac. Je souhaitais enfin m’attacher à sa dimension pédagogique et théorique et ne pas réduire ces axes à quelques pages. J’y consacre toute la dernière partie de mon livre et j’espère éclairer la bifurcation de Rameau vers ses nouvelles thèses consistant à supposer à la musique une suprématie sur les autres arts et sciences, d’où ses féroces débats avec d’Alembert. Imaginez qu’il répond à ce grand géomètre que loin d’être épuisé par leurs disputes, il s’en trouve au contraire « enhardi » ! Quelle délicieuse insolence à plus de soixante-dix ans !
Aux partisans de Rousseau, détracteurs de Rameau, que dites-vous pour atténuer voire effacer l’image tenace du Rameau érudit, intellectuel, plus théoricien qu’humain ?
 Je leur dis qu’il ne faut ni atténuer ni effacer l’image d’un Rameau érudit et intellectuel ; ils ont raison de le considérer comme tel, c’est une évidence. Pour autant, la culture, la connaissance et l’intelligence ne sont pas incompatibles avec le génie musical. Rameau était savant et théoricien, et alors ? Pour moi, il représente le père de l’interdisciplinarité, car il a su mettre la musique au cœur des débats intellectuels de l’époque en discutant avec d’Alembert, Estève, Euler, Diderot, Wolf ou encore Rousseau, son pire ennemi. Être savant, ne l’a pas empêché de nous donner une musique souvent sublime. Chacun sait que Rousseau n’était pas objectif, partagé à l’endroit de Rameau, puisque reconnaissant en Platée un chef-d’œuvre absolu, mais détestant l’homme.
Je leur dis qu’il ne faut ni atténuer ni effacer l’image d’un Rameau érudit et intellectuel ; ils ont raison de le considérer comme tel, c’est une évidence. Pour autant, la culture, la connaissance et l’intelligence ne sont pas incompatibles avec le génie musical. Rameau était savant et théoricien, et alors ? Pour moi, il représente le père de l’interdisciplinarité, car il a su mettre la musique au cœur des débats intellectuels de l’époque en discutant avec d’Alembert, Estève, Euler, Diderot, Wolf ou encore Rousseau, son pire ennemi. Être savant, ne l’a pas empêché de nous donner une musique souvent sublime. Chacun sait que Rousseau n’était pas objectif, partagé à l’endroit de Rameau, puisque reconnaissant en Platée un chef-d’œuvre absolu, mais détestant l’homme.
Dans mon livre, je montre que Rameau était certes un travailleur acharné, accaparé par ses méditations et sans doute assez peu disponible, mais qu’il a su préserver le confort de ses proches, cultiver ses amitiés, aider de jeunes musiciens, garder du temps pour l’enseignement et la pédagogie. Loin d’abandonner ses enfants (c’est facile, mais tellement tentant !), il leur a offert une vie matérielle de haute tenue, notamment en achetant à son fils Claude François la très haute charge de « valet de chambre du roi ».
Quelle représentation vous faîtes vous de l’homme Rameau à la lumière de vos propres recherches ?
Après ce long voyage avec lui, je cerne un homme difficile, mais généreux, passionné, meurtri bien souvent par un conservatisme pesant, des jalousies insupportables, combattant sur tous les fronts pour faire reculer l’ignorance. Rameau est un éternel jeune homme qui a vécu plusieurs vies. Rien ne l’arrête, ni les conventions ni les bienséances.
Rameau reste-t-il un immense génie circonscrit au Baroque tardif ou par certains côtés, peut-il être considéré comme visionnaire, lançant des passerelles vers le classicisme voire le romantisme ? En d’autres termes, l’évolution indiquée par son dernier opéra Les Boréades permet-elle d’en faire un moderne (en particulier sur le plan de l’orchestre et des instruments…) ?
Génie circonscrit au Baroque « tardif » ? Non, assurément. La longue carrière de Rameau caractérisée par une importante évolution stylistique, ne permet pas de le « classer », de le ranger dans une case. Il part de l’héritage de Couperin pour le clavecin, mais apporte à l’instrument une dimension qui en révèle d’ailleurs les limites. Son invention du passage du pouce lui permet de cultiver une virtuosité et une utilisation de tout le registre du clavier qui étaient alors inexplorées. Pour l’opéra, il chamboule tous les codes instaurés par Lully : le fond en inventant un nouveau langage, et la forme en changeant la configuration basique de l’opéra à la française. J’ai souvent écrit que Rameau n’avait d’avenir ni dans le Classicisme ni dans le Romantisme. Sa musique zappe ces périodes pour aller butiner une esthétique « moderne », proche de l’école française de l’époque debussyste. Il découvre avec délices le pouvoir de l’orchestre, confiant aux bassons des lignes audacieuses, invitant la percussion, décuplant les potentialités des cordes et des bois. Il cherche sans cesse, innove, propose et invente le concept de timbre.
Si vous deviez n’emporter sur l’île déserte que 3 ouvrages de Rameau, quels seraient-ils et pourquoi ?
C’est la question qui tue… que du papier… Alors forcément, j’emporterai des œuvres que je peux réécouter ou revisionner dans ma tête dans plusieurs mises en scène.
Donc, Platée que j’ai eu la chance de voir dans plusieurs mises en scène dont celle de Laurent Pelly avec Marc Minkowski à la direction musicale, Paul Agnew et Mireille Delunsch dans les rôles de Platée et de la Folie. Une vraie merveille ! Je pourrais me souvenir de celle conduite par Sébastien Rouland à Wiesbaden, ou celle récente de Robert Carsen avec un incroyable Marcel Beekman dirigé par Paul Agnew.
Je prendrai aussi Hippolyte et Aricie et Les Boréades qui marquent le début et la fin d’une carrière sidérante, témoignant de l’évolution stylistique du maître, de ses audaces, de ses recherches, de son génie. Hippolyte et Aricie car ce fut le début d’un choc culturel, d’une « guerre » esthétique entre Lullistes et Ramistes, le commencement d’une révolution. Les Boréades car la censure de cette œuvre en 1763 nous rappelle qu’il faut toujours lutter pour préserver sa liberté d’expression.
Et j’emporterai avec moi toutes les émotions que j’ai vécues en écoutant la musique de Rameau.
Rameau demeure la grande redécouverte des Baroqueux depuis 40 ans. Or même s’il reste assez confidentiel dans les programmations des salles d’opéras et de concerts (hormis cette année grâce à son anniversaire), le disque a permis de réévaluer considérablement sa créativité dramatique et théâtrale. Aux côtés des Haendel et des Vivaldi, quels sont selon vous les grands interprètes au xxe qui auront œuvré pour sa réhabilitation ?
C’est vrai que les Baroqueux ont œuvré pour la redécouverte de Rameau, et en premier lieu les grands maîtres que sont William Christie et John Eliot Gardiner et qu’on été Nikolaus Harnoncourt et Gustav Leonhardt. Pourtant aujourd’hui, je crois que la notion de « baroqueux » n’est plus valable et des chefs comme Marc Minkowski, Hervé Niquet, Christophe Rousset et Hugo Reyne ont contribué à cette évolution. En outre, Rameau est souvent programmé en Allemagne avec des orchestres modernes, et, au risque de choquer, je pense que c’est très bien pour sa démocratisation. Je suis enthousiasmée lorsque des chefs non spécialisés dans le baroque s’attèlent à ce répertoire comme Ivor Bolton ou Ryan Brown. Enfin, une génération de jeunes chefs très engagés comme Emmanuelle Haïm, Jonathan Huw Williams, Raphaël Pichon ou Sébastien d’Hérin apportent leurs visions actuelles qui ont toutes leurs intérêt. L’heure n’est plus à la réhabilitation, mais à la démocratisation ; nous sommes dans une phase jouissive qui fait entrer son œuvre au répertoire des théâtres lyriques d’Europe et d’ailleurs. C’est précisément la reconnaissance internationale que souhaitait Rameau… lui qui était « ivre de joie » quand le public l’acclamait.
Livres. Sylvie Bouissou vient de publier chez Fayard, une nouvelle biographie de Jean-Philippe Rameau (lire la critique complète de Jean-Philippe Rameau par Sylvie Bouissou).




