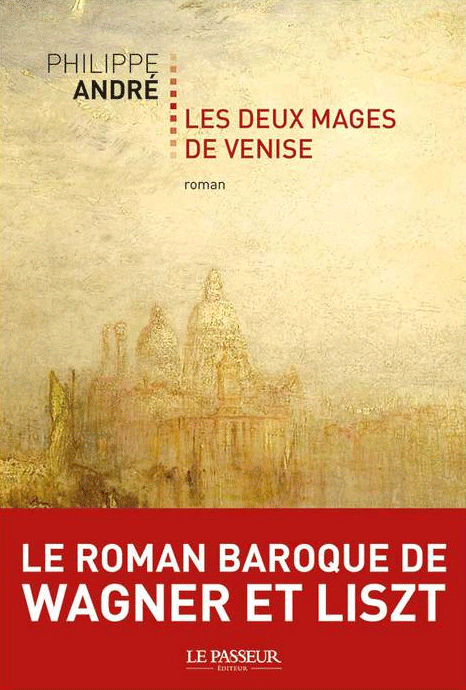 LIVRES. Philippe André. Les deux mages de Venise, roman. Editions Le Passeur (2015). Wagner est mort à Venise en 1883, c’est connu. Et il avait reçu, trois mois avant, la visite de son beau-père, Liszt, « installé » pendant deux mois au Palais Vendramin, la résidence de Richard, Cosima et l’enfant Siegfried. Qu’ont-ils fait, hormis se retrouver et parfois se chamailler ? Philippe André leur invente de « nouvelles aventures » dans une Venise hivernale et fantasmagorique. C’est, adossé à la science musicologique du spécialiste schumanno-lisztien, la nouveauté des Deux Mages, un passionnant « romansonge ». Question et réponse de la duchesse : « Aimez-vous Wagner ? », eût pu demander en toute fausse candeur la duchesse de Sagan. C’te question ! Naturlich, ma biche ! J’insiste, pourtant : aimez, et je souligne the question qui n’est pas to be or not to be. Bien sûr qu’il est, Wagner, d’une essence irréfragable, plus être que lui on n’en fait plus. Mais j’ai demandé : aimez. Il est permis de nuancer votre answer…Alors, vous me mettez plus à l’aise. Je sais ce que cette Oeuvre Totale apporte à l’histoire de la musique et des arts. Et puis vous dites qu’on a droit au clivage ? Lohengrin, Tannhauser, Tristan, Parsifal, trois fois oui. Pour la Bande des Quatre organisée en Tétralogie, franchement, vous repasserez . And Herr Richard Wagner himself, pas mieux ? Encore plus franchement, danke schön ! Même quand il joue son ultime rôle dans Der Tod in Venedig ? Faut ben mourir quéqu ’ part !
LIVRES. Philippe André. Les deux mages de Venise, roman. Editions Le Passeur (2015). Wagner est mort à Venise en 1883, c’est connu. Et il avait reçu, trois mois avant, la visite de son beau-père, Liszt, « installé » pendant deux mois au Palais Vendramin, la résidence de Richard, Cosima et l’enfant Siegfried. Qu’ont-ils fait, hormis se retrouver et parfois se chamailler ? Philippe André leur invente de « nouvelles aventures » dans une Venise hivernale et fantasmagorique. C’est, adossé à la science musicologique du spécialiste schumanno-lisztien, la nouveauté des Deux Mages, un passionnant « romansonge ». Question et réponse de la duchesse : « Aimez-vous Wagner ? », eût pu demander en toute fausse candeur la duchesse de Sagan. C’te question ! Naturlich, ma biche ! J’insiste, pourtant : aimez, et je souligne the question qui n’est pas to be or not to be. Bien sûr qu’il est, Wagner, d’une essence irréfragable, plus être que lui on n’en fait plus. Mais j’ai demandé : aimez. Il est permis de nuancer votre answer…Alors, vous me mettez plus à l’aise. Je sais ce que cette Oeuvre Totale apporte à l’histoire de la musique et des arts. Et puis vous dites qu’on a droit au clivage ? Lohengrin, Tannhauser, Tristan, Parsifal, trois fois oui. Pour la Bande des Quatre organisée en Tétralogie, franchement, vous repasserez . And Herr Richard Wagner himself, pas mieux ? Encore plus franchement, danke schön ! Même quand il joue son ultime rôle dans Der Tod in Venedig ? Faut ben mourir quéqu ’ part !
R.W. à sa personne parlant
 Donc si vous n’avez pas la foi wagnérienne, ne faites pas semblant de croire pour bientôt super-croire. Mais laissez-vous convaincre d’aller faire un tour dans les quartiers les plus perdus de la Sérénissime, en hiver 1882-83. Guidé par R.W. à sa personne parlant – comme toujours – mais aussi adressant à sa chère Cosima une sorte de journal-intime-jours-sombres, pour raconter l’incroyable bordée métaphysique qu’il aurait menée là-bas avec son beau-père, un certain Franz Liszt, l’éblouissant compositeur- ami devenu curé-sans-paroisse mais toujours en quête d’imaginaire. Et devinez qui vous aurez pour guide et porte-parole ? Un lisztien par excellence, dont ici même nous louâmes les ouvrages savants sur Années de Pèlerinage et Suite, musicien au demeurant praticien-psy qui vient aussi d’investiguer sur la paralysie générale de Schumann. Le Docteur Philippe André, sans doute pour se délasser du culte schumanno-lisztien, cède aux démons de la Fantasie hoffmanienne : étiquetant « mages » les deux » Vénitiens » d’adoption au crépuscule de leur prodigieuse vie, il les fait basculer de l’autre côté du miroir dans l’inquiétante étrangeté que se permet parfois l’écriture scientifique dont la rigueur expérimentale aurait été mise en congé payé par un tour-operator de roman.
Donc si vous n’avez pas la foi wagnérienne, ne faites pas semblant de croire pour bientôt super-croire. Mais laissez-vous convaincre d’aller faire un tour dans les quartiers les plus perdus de la Sérénissime, en hiver 1882-83. Guidé par R.W. à sa personne parlant – comme toujours – mais aussi adressant à sa chère Cosima une sorte de journal-intime-jours-sombres, pour raconter l’incroyable bordée métaphysique qu’il aurait menée là-bas avec son beau-père, un certain Franz Liszt, l’éblouissant compositeur- ami devenu curé-sans-paroisse mais toujours en quête d’imaginaire. Et devinez qui vous aurez pour guide et porte-parole ? Un lisztien par excellence, dont ici même nous louâmes les ouvrages savants sur Années de Pèlerinage et Suite, musicien au demeurant praticien-psy qui vient aussi d’investiguer sur la paralysie générale de Schumann. Le Docteur Philippe André, sans doute pour se délasser du culte schumanno-lisztien, cède aux démons de la Fantasie hoffmanienne : étiquetant « mages » les deux » Vénitiens » d’adoption au crépuscule de leur prodigieuse vie, il les fait basculer de l’autre côté du miroir dans l’inquiétante étrangeté que se permet parfois l’écriture scientifique dont la rigueur expérimentale aurait été mise en congé payé par un tour-operator de roman.
Le p’tit Siegfried
 Le point de départ est on ne plus historique, et vous en trouverez le récit au 4e chapitre de Nuages Gris (éd.Le Passeur) : Liszt a bien séjourné « chez » les Wagner au Palais Vendramin, du 19novembre 1882 au 13 janvier 1883. Il y a joué au whist, au piano, à l’inépuisable mais intermittente amitié, à la fonction grand-paternelle (le p’tit Siegfried, fruit d’amour fou entre Richard et Cosima qui avait ainsi envoyé au désespoir son exemplaire époux Hans de Bulow), et en cette famille recomposée tout n’était pas que roses, donc on s’est chamaillé, fait la gueule, réconcilié…. A partir de ce substrat non contesté, Les Deux Mages dérape avec délices en imaginaire. Les deux amis – bien que devenus beau-père et gendre, ils sont quasiment « du même âge » – entrent en « mentir-vrai » et « romansonge », comme titrerait la nébuleuse aragonienne. « C’est moi qui rêve. J’ai piqué du pif au bout du compte. Je dors. Je rêve. Tout cela c’est moi qui le rêve. Tout ceci ce n’est pas la vie de Théodore , c’est ma mienne. Rien de tout cela n’a pu se passer en 1815…. » : c’est ce qu’avouait en galopant avec Géricault son « historien » de 1959 dans La Semaine Sainte…
Le point de départ est on ne plus historique, et vous en trouverez le récit au 4e chapitre de Nuages Gris (éd.Le Passeur) : Liszt a bien séjourné « chez » les Wagner au Palais Vendramin, du 19novembre 1882 au 13 janvier 1883. Il y a joué au whist, au piano, à l’inépuisable mais intermittente amitié, à la fonction grand-paternelle (le p’tit Siegfried, fruit d’amour fou entre Richard et Cosima qui avait ainsi envoyé au désespoir son exemplaire époux Hans de Bulow), et en cette famille recomposée tout n’était pas que roses, donc on s’est chamaillé, fait la gueule, réconcilié…. A partir de ce substrat non contesté, Les Deux Mages dérape avec délices en imaginaire. Les deux amis – bien que devenus beau-père et gendre, ils sont quasiment « du même âge » – entrent en « mentir-vrai » et « romansonge », comme titrerait la nébuleuse aragonienne. « C’est moi qui rêve. J’ai piqué du pif au bout du compte. Je dors. Je rêve. Tout cela c’est moi qui le rêve. Tout ceci ce n’est pas la vie de Théodore , c’est ma mienne. Rien de tout cela n’a pu se passer en 1815…. » : c’est ce qu’avouait en galopant avec Géricault son « historien » de 1959 dans La Semaine Sainte…
Tribu miltonienne et Nocturnes hoffmaniens
 Certes on eût pensé davantage Philippe André journalintimier du côté de son cher Franz. Eh bien non, c’est en Wagner qu’il sort d’un angle de la Piazzetta, faisant d’ailleurs tenir à son petit protégé la moins protocolaire des langues modernisées et l’entraînant dans les aventures vénitiennes les plus saugrenues. Quitte à ce que R.W. soit mené par le bout de la Fantasie, le beau-père « inventant » pour son gendre plus réticent les buts de promenades qui accouchent de situations de plus en plus hallucinatoires. « Ici le temps devient espace », et vice-versa ; le réel moins vrai –et désirable ? -que le fantasmé. On rencontre sortie des pérégrinations italiennes de l’Angleterre rebelle XVIIe une tribu miltonienne – dans la famille du Paradis Perdu, je demande le père et puis aussi les filles -, on découvre une galère « décarcassée » qui selon Franz ferait une merveilleuse salle de théâtre moderne, des allusions à un grand trou qui pourrait être un cercle infernal de Dante, et ce n’est que préface à l’embardée la plus folle, une entrée en « Nocturnes à la manière de Callot », où le savant Spallanzani, recréateur lisztien d’Olympia, « emprisonne » dans l’œil de sa poupée diabolique une Cosima qui n’en demandait pas tant…
Certes on eût pensé davantage Philippe André journalintimier du côté de son cher Franz. Eh bien non, c’est en Wagner qu’il sort d’un angle de la Piazzetta, faisant d’ailleurs tenir à son petit protégé la moins protocolaire des langues modernisées et l’entraînant dans les aventures vénitiennes les plus saugrenues. Quitte à ce que R.W. soit mené par le bout de la Fantasie, le beau-père « inventant » pour son gendre plus réticent les buts de promenades qui accouchent de situations de plus en plus hallucinatoires. « Ici le temps devient espace », et vice-versa ; le réel moins vrai –et désirable ? -que le fantasmé. On rencontre sortie des pérégrinations italiennes de l’Angleterre rebelle XVIIe une tribu miltonienne – dans la famille du Paradis Perdu, je demande le père et puis aussi les filles -, on découvre une galère « décarcassée » qui selon Franz ferait une merveilleuse salle de théâtre moderne, des allusions à un grand trou qui pourrait être un cercle infernal de Dante, et ce n’est que préface à l’embardée la plus folle, une entrée en « Nocturnes à la manière de Callot », où le savant Spallanzani, recréateur lisztien d’Olympia, « emprisonne » dans l’œil de sa poupée diabolique une Cosima qui n’en demandait pas tant…
Haarghh !
Richard se démène en érotisé hoffmannien (il est ultra-sensible aux deux « jolis globes » de l’automate, voire à sa « coquille »), malgré lui ? ou pour mieux exciter la jalousie de sa Cosima ?), et surtout il mène dialogue réitératif avec un Kobold, figure du tourmenteur qui lui laisse bien peu de répit du côté de l’angine de poitrine, ce dont il mourra bientôt. Et là, il se lâche dans le discours, parsemant ses phrases d’une interjection souffrante (« haarghh ! »,un écho du « hojoho walkyrien ? )qui nous ramène aux temps de la BD-Dargaud, de formules familières (« à ch…, aussi sec , c…ries », impact boom, du balai ! lefion…, vacherie, débectant ou vioque » ) parfois teintées de rythme célinien… Le comble du paradoxe est atteint lorsque Richard « appelle » en un flux extasié (devenant parfois injurieux ou prosaïque : « fous le camp dans ta cuisine, reste aux fourneaux ») son indispensable Cosima,(« ma passerelle pour l’éternité, mon anéantissement en si majeur »…),tout comme – peut-être ? – le romantique Kleist « rebaptisait » son Henriette Vogel (qui le lui rendait aussitôt) dans les lettres qu’ils échangèrent avant leur suicide en duo…à moins que ce ne soit aussi une allusion à « L’Union Libre » où Breton géographise les blasons du corps de la femme….
Filochard et Croquignol
De même oscille-t-on entre ces visions poétisées du parcours vénitien et les silhouettes rigolotes de la virée Filochard (R.W.)- Croquignol (F.L.), la référence sublimissime de la Femme Eternelle de R.W. et la vie embourgeoisée à Vendramin, cette grande Villa-Cosima-pieds-dans-l’eau, les éclairs de lucidité richardiens (« la boucler est peut-être le plus grand défi fait à moi-même dans cette suite d’événements ») et la surdité de qui ne comprend rien au minimalisme pianistique du beau-père en train d’inventer une autre « musique de l’avenir ». Car les rapports au réel d’histoire musicale sont aussi là : du Prométhée déchaîné, des « nuages gris », du parlé-chanté, « disastro », du « lancer mon javelot dans les espaces indéfinis », des csardas macabres, des lugubres gondoles qui ne peuvent faire illusion. De même que les manifestations d’un amour-haine perpétuel entre un beau-père et un gendre peu avare de considérations inactuelles sur le vieux Liszt, « échassier hydropique », ses cigares et ses verrues, et qui débarque du train en pleine odeur de « Wanderer à nuisances olfactives 2nde classe ».
Retrouvailles lyriques
Mais cela cède à du pur lyrisme de retrouvailles entre « amis sublimes », au détour d’une promenade dans Venise embrouillardée. Et puis il y a le récit – les musiciens en tournée de banlieue en sortiront « m.d.r » ! – de Liszt qui dézingue les afféteries bondieusardes d’un jeune organiste en mal de compliments….(« jamais je n’ai entendu rythmes plus appropriés aux hôtels de prostitution et claques somptueux…. ») . Curieux blocages – superstitieux ? – aussi de Richard avouant à son « Isolde de vie ou de mort » que justement il ne prononcera plus ce dernier mot, lui qui en veut au beau-père d’avoir « sombré dans les bigoteries qui l’ont perdu comme homme et surtout comme musicien ».
Le Wanderer a-t-il perdu la mémoire ?
Tiens, en chemin, le Wanderer, il a perdu la mémoire de ses barricades bakouniniennes en 1849, quand il militait à Dresde pour la révolution ? Ensuite, de ses errances pourchassées par les polices « anti-terroristes » de l’Ordre Monarchique, mais où tout de suite il trouve à Weimar refuge fraternel auprès de Liszt ? De sa soumission (1864), genou en terre, à son Ange bavarois Louis II , et de « ce qui s’en suivit », comme intertitrent les romans de gare au XIXe : l’argent et l’or pour édifier le Temple de Bayreuth, où se célèbrera le culte monothéiste de RW ? ? Sans oublier ses vaticinations-libelles mortifères (1850 ; puis sans remords ni retour en arrière) sur « le judaïsme dans la musique » ? Bref, il ne s’agirait plus à Vendramin-House que des « considérations d’un apolitique » rangé des voitures, dans une Venise la Rouge où pas une gondole ne bouge ? Quant à l’inconscient projeté comme javelot dans les espaces du futur, n’y-a-t-il pas absence de prémonition pour une époque où son (pré) nom de Venise, Riccardo, ne sera plus dans Bayreuth un temps désert (é) par l’œuvre Totale ? Mais on ne va tout de même pas lui reprocher, à cet « inconscient-là », le formatage de son p’tit Siegfried pour mariage(1915) avec une Frau Winifred tombant raide-dingue du Moustachu de Berchtesgaden-sous-Walhalla ! (Quel malheur, parfois, d’avoir un(e) gendre(sse) ! Mais au contraire futur, quel bonheur pour un Vénitien comme Luigi Nono de se marier (1955) avec Nuria Schoenberg et d’avoir ainsi un sacré beau-père !)
Carnets du sous-sol et Bavard
Bon, permis à un mal-wagnero-compatible de débloquer sur le divan, Dr. André ? Et repassons à l’essentiel : avec les Deux Mages, nous tenons un « roman musical » de la plus haute et exigeante qualité en imagination et écriture. Ce long et parfois imprévisible monologue rappellera, en son principe d’ivre flux parolier, les Carnets du sous-sol dostoievskien, ou le plus proche Bavard de L.R. des Forêts. Et malgré les sautes d’une humeur provocatrice tirant aussi vers la rigolade, la coda (« Je me penche et je vois des étoiles qui scintillent au fond du trou. Je plonge la tête la première en poussant un léger cri…Un cortège d’étoiles mortes ondule dans le noir. ») signale, mine de rien, qu’un mois après le départ du beau-père, le gendre aura rejoint…mais quoi, le néant ? C’était – miroir de l’éblouissante lumière solaire du Turner en couverture – le dernier cadeau de la Sérénissime et aussi « tempé-tueuse » Cité des Doges à ses hôtes. On vous le disait, il y aura toujours de la Mort à Venise ! Mais encore : « mort(s) à jamais » ?…
LIVRES. Philippe André, Les Deux Mages de Venise, éditions Le Passeur (2015). Livre papier : 18,90 €, 140×205 mm, 256 pages. Date de parution : 12 février 2015. LIRE aussi la critique du livre précédent de Philippe André : « Robert Schumann, folies et musiques » (Le Passeur, 2014), CLIC d’octobre 2014 sur classiquenews.
Illustrations : Wagner, Liszt (DR)



