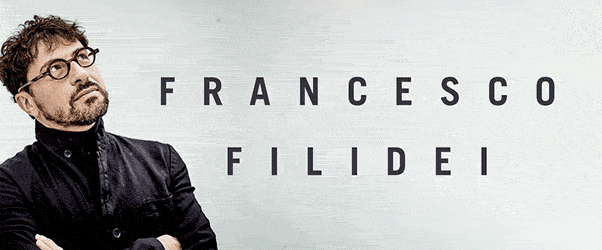Sviatoslav Richter,
Piano
(1915-1997)
Né à Zhitomir (ou Jitomir, en Ukraine), le 20 mars 1915, le jeune Sviatoslav grandit dans un foyer qui s’est tourné vers le piano. Sa mère, russe, aime Debussy et Scriabine. Son père, d’origine allemande, est lui-même pianiste, et professeur de piano à Odessa. Bien que son père l’incite à travailler sa technique et son jeu, il reste peu convaincu par le style de son fils. Pourtant le jeune pianiste s’entête, doué d’une prodigieuse mémoire comme d’un instinct musical parfait.
Passionné par la voix, il entre à l’Opéra d’Odessa, comme accompagnateur dès 15 ans, en 1930, puis comme chef de chant en 1933. Déchiffrant à vue, le jeune homme éblouit par sa technique affirmée et son tempérament original.
Il a 22 ans quand il devient l’élève du très célèbre Heinrich Neuhaus, en 1937, au Conservatoire de Moscou. Neuhaus, cousin du compositeur Karol Szymanoski, est considéré comme l’un des piliers de l’école russe de piano. Indiscipliné, renvoyé à plusieurs reprises, l’apprenti se révèle exceptionnellement doué: il obtient tous ses prix.
A 25 ans, Richter donne son premier concert public: il joue le 26 novembre 1940, à Moscou, entre autres, la Sonate n°6 de Prokofiev, lequel lui confie une nouvelle lecture de son Concerto n°5, en 1941, suscitant un immense succès.
 Mais l’année est marqué par un événement tragique: son père est fusillé par les soldats soviétiques. Son origine allemande était suspecte. Peu de jours après sa mort, les Allemands envahissent le territoire russe. L’interprète obtient le premier prix du Concours de piano de l’Urss, en 1945: il a 30 ans. Le régime officiel reconnaît ses dispositions: Richter remporte le Prix Staline en 1949, puis le titre d’Artiste du peuple, en 1955.
Mais l’année est marqué par un événement tragique: son père est fusillé par les soldats soviétiques. Son origine allemande était suspecte. Peu de jours après sa mort, les Allemands envahissent le territoire russe. L’interprète obtient le premier prix du Concours de piano de l’Urss, en 1945: il a 30 ans. Le régime officiel reconnaît ses dispositions: Richter remporte le Prix Staline en 1949, puis le titre d’Artiste du peuple, en 1955.
Le style de Sviatoslav Richter se distingue par son intensité, sa sincérité et sa liberté infaillible sur le plan musical. Anti-Horowitz, Richter, techniquement virtuose, s’impose par son intensité, son sens de la structure, la clarté de sa polyphonie, la précision de ses attaques et de ses nuances, la richesse de sa sonorité, parfois la « liberté » de ses tempos (particulièrement lents chez Schubert). Conscient de ses limites, humble devant la partition, il n’a jamais cherché à se mettre en avant. C’est un voyageur (Wunderer), curieux, habité, scrutateur des climats ténus les plus intimes de la musique… Doué d’une mémoire phénoménale (qui lui permit de jouer en doeux soirées à Pleyel, l’intégralité du Clavier bien tempéré de Jean-Sébastien Bach), le pianiste russe était d’une exigence tenace, parfois cinglante, y compris sur lui-même. D’où son fameux « je ne m’aime pas » qui signifiait son refus esthétique de tout narcissisme. Servir la musique, rien que la musique.
 En 1960, le pianiste gagne l’Europe où en Finlande, lors d’une tournée triomphale, il devient immédiatement une légende reconnue. Suit un récital à Carnegie Hall non moins mémorable et applaudi. En 1964, appréciant la France et les français: « les gens y ont un tel amour de la vie, un tel goût du bonheur!« , Sviatoslav Richter fonde le Festival de La Grange de Meslay (Touraine), s’y produisant chaque année. Il fera de même au musée Pouchkine de Moscou, fondant le festival des « Soirées de décembre ». Aujourd’hui, les cimaises du musée russe expose aussi ses tableaux, car Richter fut un peintre, assez doué.
En 1960, le pianiste gagne l’Europe où en Finlande, lors d’une tournée triomphale, il devient immédiatement une légende reconnue. Suit un récital à Carnegie Hall non moins mémorable et applaudi. En 1964, appréciant la France et les français: « les gens y ont un tel amour de la vie, un tel goût du bonheur!« , Sviatoslav Richter fonde le Festival de La Grange de Meslay (Touraine), s’y produisant chaque année. Il fera de même au musée Pouchkine de Moscou, fondant le festival des « Soirées de décembre ». Aujourd’hui, les cimaises du musée russe expose aussi ses tableaux, car Richter fut un peintre, assez doué.
Sexagénaire, l’artiste ne donne plus que des récitals dans une obscurité énigmatique qui laisse à peine visible sa silhouette imposante. Les années 1980 sont marqués par ce rituel qui renforce son aura et le jeu magnétique de l’interprète. Richter organise plusieurs tournées en Sibérie dans des lieux retirés (1986). Son dernier concert fut programmé à Lübeck, en mars 1995: il avait alors 80 ans. Sviatoslav Richter s’éteint le 1er août 1997 à Moscou.
Crédit photographique
Sviatoslav Richter (DR)
Heinrich Neuhaus (DR)
Sviatoslav Richter (DR)