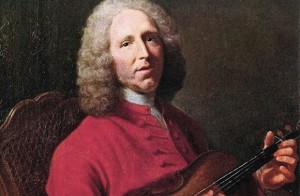 Versailles, Opéra royal. Rameau: Le temple de la gloire, mardi 14 octobre 2014, 20h. Après les Grands Motets par William Christie et Les Arts Florissants, puis la révélation d’un Requiem d’après Castor et Pollux (également mis en regard avec Mondonville) sous la direction d’Olivier Schneebeli, le château de Versailles et le CMBV, Centre de musique baroque de Versailles poursuivent leur célébration Rameau 2014, avec nouveau temps fort, l’écoute intégral de l’opéra ballet écrit avec Voltaire : Le temple de la gloire. Après une première tentative de collaboration avec Rameau autour du personnage de Samson (finalement censuré : le matériel musical sera recyclé dans ses opéras suivants), Voltaire livre un nouveau texte pour le compositeur : Le temple de la gloire. Commande du responsable des Menus Plaisirs, le duc de Richelieu, l’opéra célèbre la victoire de Louis XV à Fontenoy : la création, le 27 novembre 1745 dans le théâtre du manège de la Grande Ecurie, indique clairement l’intention de Voltaire : réformer l’opéra français en l’écartant des fadeurs sensuelles et pastorales à la mode afin de réaliser un théâtre moral, politique et philosophique. L’oeuvre est donc une commande officielle dont le ton résolument critique, l’écarte de la pure propagande comme de l’esthétique métastasienne alors prédominante à l’opéra, laquelle flatte généreusement les têtes couronnées.
Versailles, Opéra royal. Rameau: Le temple de la gloire, mardi 14 octobre 2014, 20h. Après les Grands Motets par William Christie et Les Arts Florissants, puis la révélation d’un Requiem d’après Castor et Pollux (également mis en regard avec Mondonville) sous la direction d’Olivier Schneebeli, le château de Versailles et le CMBV, Centre de musique baroque de Versailles poursuivent leur célébration Rameau 2014, avec nouveau temps fort, l’écoute intégral de l’opéra ballet écrit avec Voltaire : Le temple de la gloire. Après une première tentative de collaboration avec Rameau autour du personnage de Samson (finalement censuré : le matériel musical sera recyclé dans ses opéras suivants), Voltaire livre un nouveau texte pour le compositeur : Le temple de la gloire. Commande du responsable des Menus Plaisirs, le duc de Richelieu, l’opéra célèbre la victoire de Louis XV à Fontenoy : la création, le 27 novembre 1745 dans le théâtre du manège de la Grande Ecurie, indique clairement l’intention de Voltaire : réformer l’opéra français en l’écartant des fadeurs sensuelles et pastorales à la mode afin de réaliser un théâtre moral, politique et philosophique. L’oeuvre est donc une commande officielle dont le ton résolument critique, l’écarte de la pure propagande comme de l’esthétique métastasienne alors prédominante à l’opéra, laquelle flatte généreusement les têtes couronnées.
Après un prologue dédié à l’Envie (hommage au premier opéra de Quinault que Voltaire veut dépasser), l’opéra qui suit est un ballet qui brosse le portrait idéal du prince vertueux, digne d’admiration. Par antithèse, Voltaire épingle d’abord dans les deux premiers actes, la figure des tyrans méprisables : Bélus, trop violent (acte I), Bacchus, trop efféminé (acte II); tout cela pour mieux souligner les vertus du héros parfait : Trajan, couronné de lauriers par la Gloire (acte III).
 Voltaire apporte sa connaissance aiguë du théâtre : celui moral de Corneille (Cinna) qui inspire la Clémence de Titus de Métastase, lequel influence le profil de Trajan ici, qui après avoir vaincu les souverains rebelles, sait leur pardonner (III). Un pouvoir ne saurait être digne s’il ne peut se montrer humain. Voltaire va plus loin encore en imaginant Trajan héroisé, refuser les honneurs et la gloire ; puis, dédier sa victoire au peuple romain et au bonheur public. Incroyable surenchère morale… dont on doute que Louis XV et la Cour de Versailles aient réellement compris les enjeux et le sens humaniste. De toute évidence, le livret est d’un modernité intellectuelle et politique.
Voltaire apporte sa connaissance aiguë du théâtre : celui moral de Corneille (Cinna) qui inspire la Clémence de Titus de Métastase, lequel influence le profil de Trajan ici, qui après avoir vaincu les souverains rebelles, sait leur pardonner (III). Un pouvoir ne saurait être digne s’il ne peut se montrer humain. Voltaire va plus loin encore en imaginant Trajan héroisé, refuser les honneurs et la gloire ; puis, dédier sa victoire au peuple romain et au bonheur public. Incroyable surenchère morale… dont on doute que Louis XV et la Cour de Versailles aient réellement compris les enjeux et le sens humaniste. De toute évidence, le livret est d’un modernité intellectuelle et politique.
Après avoir été boudé par le public parisien qui y cherchait vainement une intrigue amoureuse, l’ouvrage est remanié par Rameau et présenté modifié en avril 1746 à l’Académie royale de musique à Paris : Bélus, trop violent est finalement adouci par les bergers, et Trajan chante un tendre ramage d’oiseaux à son épouse (!), selon l’esthétique galante et suave à la mode. Entre temps, Voltaire se désolidarise de la nouvelle mouture et est même élu à l’Académie française pendant les représentations. Ce 14 octobre, l’Opéra royal présente la dernière version de 1746.
Dès l’ouverture, l’instrumentarium requis par Rameau – au sommet de son travail réformateur et expérimental car il vient de composer Platée, comédie lyrique déjantée qui renouvelle le genre lyrique en 1745 -, l’orchestre affirme sa couleur spécifiquement guerrière et glorieuse (2 petites flûtes, 2 trompettes, 2 cors…). Puis ce sont 2 bassons obligés pour le monologue de l’Envie dans le Prologue (Profonds abîmes du Ténare) : un air très applaudi à l’époque et repris de moults concerts.
Au I, Lydie chante un air italien contrasté et vocalisé, passant de la déploration à la fureur : elle aime Bélus qui terrorise les bergers. Le tyran se laisse convaincre par le ballet pastoral sui suit d’une séduction littéralement irrésistible : Bélus entend désormais se faire aimer plutôt que craindre.
Le II est devenue une ample bacchanale, prétexte à un long divertissement dansé et chanté : vainqueur aux Indes, Bacchus entre au temple de la gloire avec son épouse Erigone : mais il se voit écarté par le grand prêtre. Peu importe, il continue son chemin vers d’autres lieux, où le plaisir est célébré.
Au III, L’impératrice Plautine se languit en une longue scène tragique, du retour de son époux Trajan parti à la conquête de Parthia. Le double choeur des Prêtres de Vénus et de Mars, très distinctement caractérisé, sollicite les dieux pour protéger l’empereur (Rameau y excelle dans leurs gavotte et rigaudons). Trajan revient victorieux avec les rebelles parthes soumis : dans la scène capitale du pardon de Trajan, où l’orchestre atteint à ce sublime moral que Voltaire appelait de tous ses voeux, Rameau réussit un nouveau double choeur à l’effet solennel et grandiose : 5 voix des rois parthes et choeur du peuple romain. La descente de la Gloire suscite le divertissement final qui prépare à l’ariette de Trajan, devenu clément et galant, par son chant pastoral (ramage aux oiseaux). L’air final reprend les petites flûtes et les cors par deux, tels que déjà exposés dans l’ouverture.
Rameau, Opéra royal de Versailles.
Mardi 14 octobre 2014, 20h
Durée avec l’entracte (situé après le premier acte) : 2h45
Judith Van Wanroij : Lydie, Plautine
Katia Velletaz : Une bergère, une bacchante, Junie
Chantal-Santon-Jeffery : Arsine, Érigone, la Gloire
Mathias Vidal : Apollon, Bacchus, Trajan
Alain Buet : L’Envie, Bélus, le Grand Prêtre de la Gloire
Choeur de chambre de Namur
(Thibaut Lenaerts, chef de choeur)
Les Agrémens
Guy Van Waas, direction




